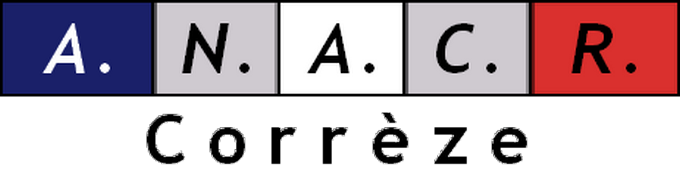Nouvelles
Bulletin n° 51, décembre 2025
Histoire : Contextualiser les réformes de la Libération, 1945-46 .
Lorsque le Conseil National de la Résistance (CNR) publie son programme d'action « les Jours Heureux » le 15 mars 1944, il s'agit d'abord de libérer le territoire, de le reconstruire, puis de traduire les volontés et les espoirs de réformes des français, qui ont résisté à l'occupation nazie et au régime collaborateur de Vichy. La guerre est loin d'être terminée, la libération complète et le rétablissement de la République, n'interviendront que dans plusieurs mois, voire un an plus tard.
Dans quelles conditions ces réformes et la reconstruction du pays vont-elles se mettre en place ?
Depuis 1940, la France a été confrontée à des destructions matérielles et humaines considérables liées aux opérations militaires allemandes puis alliées, à la répression menée contre la Résistance, aux exigences allemandes de l'Armistice du 22 juin 1940, très largement satisfaites voire anticipées par le gouvernement de Pétain.
Bilan humain :
Les combats terrestres de la Wehrmacht et aériens de la Luftwaffe (bombardements... ) de la « campagne de France » en mai juin 1940 ont coûté la vie à près de 60 000 soldats français, on a décompté plus de 120 000 blessés et 1 850 000 prisonniers, dirigés vers les Stalags et les Oflags allemands, où beaucoup sont utilisés comme main d’œuvre. 20 000 Résistants seront tués au combat, 30 000 fusillés, 60 000 déportés dont près de la moitié ne sont pas revenus. Pour répondre aux exigences croissantes de main d’œuvre depuis 1940, la propagande allemande va recruter près de 100 000 travailleurs français destinés à remplacer les pertes humaines de la Wehrmacht, notamment sur le front de l'Est. Dans ce but, le régime de Vichy instaure la « Relève » en juin 1942 (3 ouvriers qualifiés français partant pour l'Allemagne, contre le retour d'un soldat prisonnier), celle-ci devient obligatoire en septembre, mais comme elle ne rencontre pas le succès escompté, elle est remplacée en février 1943 par le « Service du Travail Obligatoire » (STO), mesures qui mobiliseront au bout du compte de l'ordre de 650 000 travailleurs (dont 26 000 ne sont pas revenus) au service de l'Allemagne (ceci, malgré un nombre important de « réfractaires » passés à la Résistance). Enfin ce sont plusieurs dizaines de milliers de civils tués lors des bombardements alliés (Normandie, Royan...). Ce sont là des drames familiaux, des forces vives soustraites à l'économie française, des victimes qu'il va falloir prendre en charge au retour des camps.
En 1944, la libération progressive du territoire révèle non seulement les dommages aux biens liés aux hostilités , mais aussi les dommages aux personnes : la population civile est meurtrie, rationnée, appauvrie. La mortalité infantile dépasse 100 pour 1000 dans certaines régions ; les cartes de rationnement vont perdurer jusqu'en 1949.
Bilan matériel :
La destruction matérielle du territoire national fait suite aux attaques allemandes de la bataille de France, qui ont ravagé les villes du nord, détruit l'essentiel de l'armement français, puis aux bombardements aériens des Alliés, qui anéantissent, principalement à partir de 1943, partiellement ou totalement les ports , de nombreuses agglomérations et les réseaux de communication, particulièrement le réseau ferroviaire (touché aussi par des actions de la Résistance). Les combats urbains de la libération participent aux destructions, le patrimoine immobilier est durement touché, ce qui déclenche une crise du logement à la sortie de la guerre. Dès la fin du conflit, la reconstruction s'amorce... mais avec quels moyens ?
La France a dû supporter le poids de l'occupation allemande, fixé par la Convention d'armistice du 22 juin 1940 : versement de 400 millions de Francs par jour, puis 500 millions à partir de novembre 1942 et l'occupation de la zone sud, pour l'entretien de l'armée allemande (sans compter les frais de l'occupation italienne). Ce qui représenterait aujourd'hui une somme de plus de 75,5 millions d'Euros par jour, soit le budget annuel cumulé de l'Education nationale et de la police en 2024. La commission du coût de l'occupation, créée en octobre 1944 évalue le coût de la guerre et de l'occupation pour la France à 4 896 milliards de francs, valeur de 1945. Sont compris, les destructions allemandes ou alliées de toute sorte, le pillage des ressources, des biens de consommation grâce au taux arbitrairement surévalué du reichsmark, les spoliations, les réquisitions des machines les plus modernes transportées outre-Rhin, les chevaux, les prélèvements de près de 30% de la production de charbon, 74% du minerai de fer, 50% de la bauxite, les prélèvements de 21% de la viande, 13% du blé, le lait, le beurre, et autres denrées alimentaires transférées en Allemagne, avec l'aide de l'administration française. Les actions de la Résistance n'ont pu soustraire qu'une petite partie de ces biens aux réquisitions. La raréfaction des biens alimentaires a développé la pratique du « marché noir », accentuant les difficultés des plus démunis, notamment dans les villes. Le ravitaillement des populations est une tâche urgente, à laquelle va s'attacher le gouvernement provisoire, avec les efforts d'une paysannerie française affaiblie, où les femmes ont dû faire face à la forte diminution de la main d’œuvre masculine.

La reconstruction :
A l'été 1945, l'industrie française doit convertir une production de guerre dans le cadre d'une économie de paix, alors qu'elle s'est considérablement appauvrie durant le conflit …
La reconstruction apparaît comme une priorité nationale et mobilise l'ensemble du corps social. Elle avance rapidement et connaît une progression spectaculaire jusqu'en 1947, grâce à la mobilisation syndicale et à la détermination des ouvriers. Malheureusement elle ne peut pas compter sur les réparations allemandes que la Commission des réparations qui s'est tenue à Moscou, a déterminées « en nature », à un montant global de 20 milliards de Dollars, ne réservant qu'une part marginale à la France. Notre pays n'a droit qu'à des prélèvements sur « l'outillage industriel et les navires » et « sur les avoirs allemands et les réparations fournies sur la production courante allemande ».
Malgré tout, le Gouvernement Provisoire de la République Française (GPRF) du Général De Gaulle , s'appuyant, dès novembre 1944, sur un emprunt d'Etat qui va lever 164,4 milliards de Francs, et diverses souscriptions, s'efforce de réaliser le programme du Conseil National de la Résistance. Les chantiers qui s'engagent concernent en partie la réhabilitation des structures industrielles et de transport. Ils sont mis en place à partir de décembre 1944 : nationalisation des Houillères du Nord et du Pas de Calais, des usines Renault et des transports aériens.


Le Gouvernement s'applique en outre à procurer aux Français un travail, les soins dont ils ont un grand besoin, à verser leurs pensions aux victimes de guerre et essaie d'enrayer les pénuries et le dénuement. Les réformes à venir se négocient grâce à un travail commun entre les syndicats de salariés (qui n'ont pas trahi!) et patronaux (même si le Général De Gaulle a dit qu'il « ne les a pas vus à Londres »...). Elles aboutissent à la publication des ordonnances de 1945 :
Le 22 février 1945 sont institués les comités d'entreprise qui permettent une représentation salariale à l'intérieur des entreprises de plus de 100 salariés.
Un système de couverture des risques sociaux est adopté par les ordonnances d'octobre. L'article 1er de celle du 4 octobre dispose qu' « il est institué une organisation de la sécurité sociale destinée à garantir les travailleurs et leurs familles contre les risques de toute nature susceptibles de réduire ou de supprimer leur capacité de gain , à couvrir les charges de maternité et les charges de famille qu'ils supportent ». Voici ce qu'en dit le ministre (Communiste) Ambroise Croizat le 8 août 1946, dans un discours à l'Assemblée : « l'ordonnance du 4 octobre 1945 […] a été le produit d'une année de travail au cours de laquelle des fonctionnaires, des représentants de tous les groupements et de toutes les organisations intéressées, des membres de l'Assemblée consultative provisoire, dont certains font partie de la présente Assemblée, ont associé leurs efforts pour élaborer un texte que le gouvernement de l'époque a en définitive consacré, conformément à l'avis exprimé par 194voix contre 1 à l'Assemblée consultative. […] Le plan de sécurité sociale est une réforme d'une trop grande ampleur , d'une trop grande importance pour la population de notre pays pour que quiconque puisse en réclamer la paternité exclusive.
Cette sécurité sociale, née de la terrible épreuve que nous venons de traverser, appartient et doit appartenir à tous les Français et toutes les Françaises, sans considérations politiques, philosophiques, ou religieuses. C'est la terrible crise que notre pays subit depuis plusieurs générations qui lui impose ce plan national et cohérent de sécurité. »
L'ordonnance du 18 octobre 1945 pourvoit à la création d'un Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives consacré au développement de l'énergie nucléaire.
La loi du 2 décembre 1945 prévoit la nationalisation de la Banque de France et des grandes banques ainsi que l'organisation du crédit.
Malgré le défi considérable qu'elles représentent pour une France exsangue, ces mesures vont constituer, jusqu'à nos jours, le socle du modèle avancé de protection sociale français.
Des lois ultérieures vont le faire évoluer vers une privatisation progressive des services publics, détricotant la lettre et l'esprit du CNR, comme celui de la constitution de 1946, dont le préambule mérite une lecture attentive pour éveiller les consciences aujourd'hui face à la situation économique et politique de notre pays.

Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946
( source : https://www.conseil-constitutionnel.fr/le-bloc-de-constitutionnalite/preambule-de-la-constitution-du-27-octobre-1946 )
1. Au lendemain de la victoire remportée par les peuples libres sur les régimes qui ont tenté d'asservir et de dégrader la personne humaine, le peuple français proclame à nouveau que tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés. Il réaffirme solennellement les droits et libertés de l'homme et du citoyen consacrés par la Déclaration des droits de 1789 et les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République.
2. Il proclame, en outre, comme particulièrement nécessaires à notre temps, les principes politiques, économiques et sociaux ci-après :
3. La loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l'homme.
4. Tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d'asile sur les territoires de la République.
5. Chacun a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi. Nul ne peut être lésé, dans son travail ou son emploi, en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances.
6. Tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l'action syndicale et adhérer au syndicat de son choix.
7. Le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent.
8. Tout travailleur participe, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises.
9. Tout bien, toute entreprise, dont l'exploitation a ou acquiert les caractères d'un service public national ou d'un monopole de fait, doit devenir la propriété de la collectivité.
10. La Nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement.
11. Elle garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l'incapacité de travailler a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence.
12. La Nation proclame la solidarité et l'égalité de tous les Français devant les charges qui résultent des calamités nationales.
13. La Nation garantit l'égal accès de l'enfant et de l'adulte à l'instruction, à la formation professionnelle et à la culture. L'organisation de l'enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l'Etat.
14. La République française, fidèle à ses traditions, se conforme aux règles du droit public international. Elle n'entreprendra aucune guerre dans des vues de conquête et n'emploiera jamais ses forces contre la liberté d'aucun peuple.
15. Sous réserve de réciprocité, la France consent aux limitations de souveraineté nécessaires à l'organisation et à la défense de la paix.
16. La France forme avec les peuples d'outre-mer une Union fondée sur l'égalité des droits et des devoirs, sans distinction de race ni de religion.
17. L'Union française est composée de nations et de peuples qui mettent en commun ou coordonnent leurs ressources et leurs efforts pour développer leurs civilisations respectives, accroître leur bien-être et assurer leur sécurité.
18. Fidèle à sa mission traditionnelle, la France entend conduire les peuples dont elle a pris la charge à la liberté de s'administrer eux-mêmes et de gérer démocratiquement leurs propres affaires ; écartant tout système de colonisation fondé sur l'arbitraire, elle garantit à tous l'égal accès aux fonctions publiques et l'exercice individuel ou collectif des droits et libertés proclamés ou confirmés ci-dessus.